Explorons en profondeur... Harry Potter, un livre fait de livres
- François Comba
- 5 févr. 2017
- 13 min de lecture

Puisque je suis invité à parler de Harry Potter dans une médiathèque, qui est surtout pour moi, depuis quarante ans, une bibliothèque, je vais essayer de vous montrer que ce livre est fait de livres, parfois très anciens, avec lequel ce grand roman de notre temps entretient une sorte de dialogue.
Pour s’en rendre compte, il suffit d’ouvrir le texte, ce que je vais faire devant vous. Je prends ce gros volume – à la couverture, vous aurez reconnu le tome VII, les Reliques de la Mort. Je passe une première page de titre, une deuxième page de titre, la page des dédicaces, et j’arrive à ces vers :
Ô souffrance innée !
Malheur horrible, plaie ruisselante de sang !
Hélas ! Lamentable, insupportable affliction !
Hélas ! Douleur impossible à apaiser !
Mais c’est dans la maison
Que se trouve le remède, il ne viendra pas d’ailleurs,
Mais d’elle-même
À travers une sanglante, une cruelle discorde.
Allons, entendez, dieux bienheureux des Enfers,
Cette prière ; et envoyez de bonne grâce un secours
À ces enfants pour que leur vienne la victoire.
Juste en-dessous de cette violente épigraphe, la référence est indiquée : Eschyle, Les Choéphores (Les Porteuses de libations).
Eh oui ! à l’inverse de ce que font si souvent les écrivains britanniques en tête de leurs ouvrages, J. K. Rowling ne cite pas Shakespeare, mais Eschyle ! Aussi convient-il de se demander pourquoi elle le fait.
Eschyle, qui est-ce ? – Un Grec, certes, mais encore ?
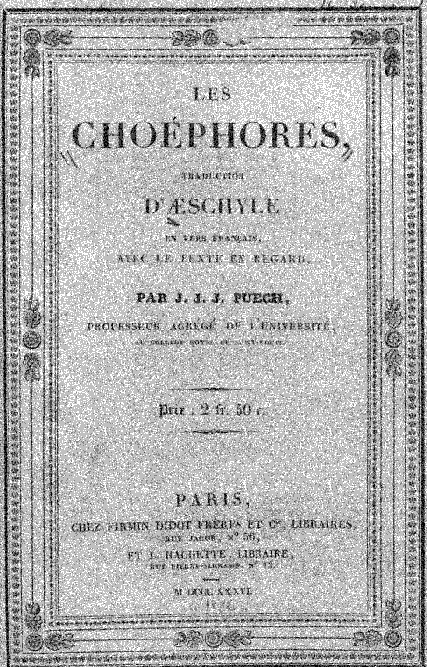
Il arrive deux bons siècles après Homère, et il naît à Athènes, dans une famille de l’aristocratie. Son nom, en grec, se prononce A-is-ku-los – ne me demandez pas comment on a pu passer d’Aïskulos à Eschyle, je n’en sais rien ! Il a combattu les Perses, à la fameuse bataille de Marathon, en 490 avant J.-C., puis à Salamine, en 480. Il avait alors quarante ans. C’est le premier tragique grec, maintes fois lauréat, les deux suivants étant Sophocle et Euripide. Il mourut fort âgé, en Sicile, en 456 ; une tortue, lâchée par un aigle, lui serait tombée sur la tête.
Vous l’aurez noté, c’est un tragique – un dramaturge donc, qui livre des pièces violentes et tristes, ponctuées de crimes et de fautes, et qui normalement finissent mal. Je dis normalement parce que, justement, dans le cas d’Eschyle, c’est plus compliqué ; sa vision est imprégnée d’idées noires, mais son pessimiste n’est pas certain. En effet, la pièce que cite J. K. Rowling appartient à une trilogie, consacrée à Oreste ; elle en est le deuxième volet. Or, si l’on pousse la lecture jusqu’au troisième, on découvre qu’Oreste se sort de la tragédie : un tribunal l’acquitte. Pas n’importe quel tribunal, pas un tribunal de complaisance : un tribunal de citoyens, un tribunal démocratique, le premier du genre, en tout cas le plus ancien dont la littérature ait gardé la trace. Pour atténuer le tragique de la condition humaine, Eschyle compte sur la politique ; « ni anarchie, ni tyrannie », il compte même sur la démocratie.
Vision tragique, confiance en la démocratie… ça fait déjà deux points communs entre Eschyle et Rowling. Vous en aurez peut-être relevé un troisième dans l’épigraphe : « Envoyez un secours à ces enfants pour que leur vienne la victoire. » Il est ici question de souffrances infligées à des enfants, et c’était une première ! Si vous relisez Homère, vous trouverez des héros en larmes, mais tous adultes : Homère ne met pas d’enfants en scène ; Eschyle, si.
Premier tragique de l’histoire du monde, premier écrivain démocrate, et le premier qui se soit soucié des enfants, on commence à comprendre pourquoi J. K. Rowling a cité Eschyle en tête du dernier tome. Il y a, selon un procédé stylistique qui lui est cher – j’y reviendrai, – une sorte d’inclusion.

Arrivé à ce point de notre propos, on a déjà compris qu’il n’y a pas de hasard dans le travail de Mrs Rowling. Le seul fait qu’elle se soit référée à un auteur si enfoui était en soi un indice, car il se trouve que, des tragiques athéniens qui jalonnent le Ve siècle avant J.-C., Eschyle est celui que notre époque néglige. Porté tantôt par Freud, tantôt par Anouilh, tantôt par Pasolini, Sophocle figure au programme des terminales littéraires ; et Euripide, parce qu’il enferme ses Troyennes dans un camp d’esclaves en transit, inspire des mises en scène ; mais Joanne Rowling est bien le seul auteur « grand public » à s’intéresser à Eschyle.
Autrement dit, cette dame est cultivée, au vrai sens du terme : d’une part, elle a lu beaucoup plus de livres anciens et prestigieux que la plupart des gens ; d’autre part, ces livres la guident, ils l’aident à vivre et à écrire.
Tel sera donc ici le sens de mon propos : mettre un texte publié à Londres, entre 1997 et 2007, en rapport avec des textes antérieurs, – avec, en filigrane, une analogie que me souffle la tragédie grecque. Chez les Grecs, si la tragédie peut avoir lieu, c’est parce qu’elle a déjà eu lieu : si Oreste tue sa mère, c’est parce qu’elle avait tué son père ; et si Clytemnestre a tué son mari Agamemnon, c’est parce qu’Agamemnon avait sacrifié leur fille Iphigénie.
Eh bien ! en art, il arrive qu’un phénomène analogue se produise. Si Harry Potter est un miracle, c’est parce que le miracle a déjà eu lieu, parce que cet écrit est en partie la réécriture de miracles antérieurs. À la première lecture, tout y est neuf ; à la relecture, tout y est ancien. Ça paraît contradictoire, incompatible, mais les deux lectures sont également justes. Je vous entraîne dans la deuxième… Je fais comme Hermione, qui, dans le tome II, dans tous d’ailleurs, « fonce à la bibliothèque » !
Pour le prologue du premier tome, À l’école des sorciers, J. K. Rowling a combiné l’enfance de Mowgli et celle de Jésus :
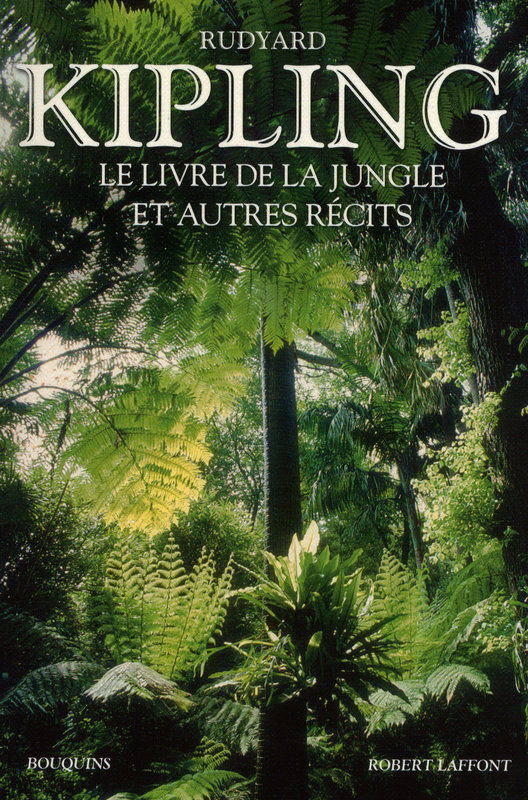
Vous savez que Mowgli est une invention de Kipling. Walt Disney en a fait un dessin animé, simplifié, destiné aux petits enfants ; et l’on a oublié – les écologistes ont oublié – que c’était, paru en 1894, le premier conte où les animaux n’étaient pas conçus à l’imitation des hommes, le premier qui concevait la nature comme un monde qui a son intégrité, sa dignité, en regard de quoi les sociétés humaines ne sont qu’un ramassis de brutes qui ne respectent rien.
Le tigre Shere Khan préfigure Voldemort : il veut sa « proie », un « petit d’homme », un bébé, farouchement défendu, non par sa mère qui s’est enfuie, mais tout de même par « Mère louve ». Comme Harry, Mowgli est donc un rescapé ; comme Harry, il est aidé – par le vieux loup Akela, « aigle » en latin, qui fait songer à Dumbledore et à son nez « aquilin », en bec d’aigle, – par Bagheera la panthère, qui évoque McGonagall, dans la mesure où celle-ci est un animagus qui se change en chat, en félin, – par l’ours Baloo qui s’apparente à Hagrid. Face à ces loyaux protecteurs de l’enfant, le tigre peut compter sur de jeunes loups qui annoncent les mangemorts ; et Mowgli s’est entendu dire « qu’un jour ou l’autre il lui faudrait tuer Shere Khan », qui en veut à sa vie comme Voldemort à celle de Harry.
Le roman reprend donc le conte de Kipling, mais J. K. Rowling a aussi pioché dans deux évangiles : Matthieu et Luc, l’un et l’autre écrit en grec – décidément !..., un demi-siècle après la mort de Jésus, à un moment où des légendes apparaissaient pour envelopper sa naissance.
Harry Potter débute par une Nativité, sauf que c’est plutôt une résurrection, avec Dumbledore, McGonagall et Hagrid en Rois mages, – et c’est aussi un Massacre des innocents qui ne laisse qu’un survivant. Désormais, son physique le distingue, car la cicatrice au front fait de Harry un être marqué, un corps écrit, a riddle (une énigme – Riddle étant le nom anglais de Jedusor-Voldemort) à déchiffrer.
La suite de ce premier tome, À l’école des sorciers, doit beaucoup à Cendrillon de Charles Perrault, et surtout ressemble à l’enfance de Jane Eyre, – le roman de Charlotte Brontë que toutes les Anglaises lisent à l’adolescence. Les deux protagonistes se sont retrouvé orphelins à peu près au même âge. La tante Pétunia étant tenue par un serment comme l’était la tante Reed, les Dursley ont recueilli Harry, mais ils ne l’aiment pas plus que Mrs Reed n’aimait Jane Eyre. De son côté, le gros Dudley brutalise son cousin Harry en toute impunité comme John Reed brutalisait sa cousine Jane.
Je passe au tome II, Harry Potter et la chambre des Secrets.
Vous l’aurez remarqué, beaucoup de formules magiques rendent un son latin. De fait, J. K. Rowling a fait des études de latin, littérature antique et littérature médiévale, à Édimbourg d’abord, à la Sorbonne ensuite, donc en français. Tout cela se retrouve dans son roman, qui doit aux Métamorphoses d’Ovide, à Perceval de Chrétien de Troyes, au Roland furieux de Ludovico Ariosto, qu’on appelle l’Arioste.
Tel Apollon tuant Python – « à flots son venin coula par les noires blessures », Harry tue le basilic : « Harry sentit alors un flot de sang tiède ruisseler sur sa manche » ; puis il transperce le journal de Tom Jedusor avec un des crochets venimeux : « Un flot d’encre jaillit du livre ». Harry est un nouveau Persée, puisque le basilic a ceci de commun avec Méduse, la pire des Gorgones, qu’il pétrifie ceux qui croisent son regard. Dans une version du mythe qu’Ovide ne retient pas, mais que Mallarmé connaissait, Persée, pour se rendre invisible, disposait du casque d’Hadès ; Harry a sa cape. Persée sauvait, puis épousait Andromède ; Harry sauve, puis épouse Ginny. Le parallélisme est indéniable.
Dans cet épisode, J. K. Rowling s’inspire aussi du Roland furieux de l’Arioste, où Roger, à l’instar de Persée, affronte un orque pour sauver Angélique enchaînée à un rocher. L’Angélique de Harry se prénomme Ginevra (ça nous est dit lors du mariage de Bill, « Ginny » n’étant qu’un diminutif), comme une princesse écossaise du Roland furieux, et l’hippogriffe Buck, qui sauve Sirius dans le Prisonnier d’Azkaban, aussi vient de l’Arioste.
Ce troisième tome, le Prisonnier d’Azkaban, comporte d’ailleurs un amusant clin d’œil. C’est au début, Harry fait du shopping sur le chemin de traverse, et il avise, dans une vitrine, « une tortue géante à la carapace incrustée de pierres précieuses ». Elle vient de À rebours, roman paru en 1884, publié par le premier J. K. de la littérature, pas J. K. Rowling, mais Joris Karl Huysmans. Son héros, Des Esseintes, accumule les étrangetés, notamment celle de faire orner de pierreries la carapace de sa tortue. La tortue en meurt, mais le roman a survécu et Mrs Rowling s’en souvient. Elle a bonne mémoire d’ailleurs.
À la fin de la Coupe de feu, on repère une réminiscence du Richard III de William Shakespeare. C’est au cimetière, lors du duel que Voldemort impose à Harry, l’épisode du priori incantatum : comme le roi criminel de Shakespeare, Voldemort est assailli par les ombres de tous ceux qu’il a assassinés.
D’autres épisodes ultérieurs ont été puisés à d’autres sources. Songeons à la mort de Dumbledore, dans le Prince de Sang-Mêlé, dont je trouve le modèle dans Sans famille d’Hector Malot (1878). Enfant trouvé, Remi ignore qu’il a été enlevé à sa vraie famille ; il découvre la vérité juste avant d’être arraché à sa mère adoptive. Mais son nouveau ravisseur est un bon maître : Vitalis lui apprend à lire, aussi la musique, et à en jouer, et à en vivre. Avec sa barbe blanche, sa bienveillante fermeté, son savoir immense et son passé enfoui, Vitalis rappelle Dumbledore. Sa mort désespère Remi : comment faire maintenant ? Mais il a tort car Vitalis l’a bien formé – ce qui veut dire : formé à se passer de lui. Or quand Dumbledore est tué, Harry n’a plus besoin de lui.
Et c’est là que j’échappe à la tentation du catalogue pour tenter de dégager le sens de ces emprunts. Car l’emprunteur ne fait pas du plagiat ; il invente ce qu’il emprunte.

C’est flagrant en peinture. En 1814, Goya livre un chef d’œuvre, le Tres de mayo. On y voit les grenadiers du maréchal Murat qui, de nuit, fusillent des patriotes espagnols qu’ils viennent d’arrêter. En 1867, Édouard Manet se souvient d’avoir vu ça exposé à Madrid et il peint sur le même modèle, avec la même composition, L’Exécution de Maximilien. En 1951, c’est Picasso qui a son tour reprend la composition horizontale de Goya et les gris froids de Manet pour réaliser Les Massacres de Corée. À chaque fois, on devine la source ; on est d’ailleurs censés la deviner, la reconnaître, faire le lien. Pour autant, il ne viendrait à l’idée de personne de dire que Manet et Picasso « ont copié ». Quand elle emprunte, J. K. Rowling s’approprie un texte ancien et elle en fait quelque chose de neuf, qui est son art propre. Et c’est encore à d’autres emprunts qu’il convient de demander le sens de son art.
Je crois qu’elle aimerait qu’on devienne des petits Potter, c’est-à-dire des gens qui préfèrent la vérité à leurs opinions, qui préfèrent le courage à leur petite personne et qui préfèrent la vie à la mort. C’est pourquoi elle emprunte à Sophocle, à Chrétien de Troyes, aux évangiles.
À Sophocle d’abord, – je l’ai déjà nommé. Lui aussi a participé à la bataille de Salamine, mais il n’avait que seize ans et il ramait sur une trière. Par la suite, il a été élu stratège aux côtés de Périclès.

On lui doit Œdipe roi, qu’on date de 426-425 avant J.-C. Vous connaissez l’histoire. La peste s’est abattue sur Thèbes, la ville dont Œdipe a épousé la reine, Jocaste, et qu’il gouverne donc. Que faire pour arrêter fléau ? Comment calmer les dieux ? Il pose la question au devin Tirésias qui lui dit de punir le meurtrier du précédent mari de Jocaste, Laïos. Œdipe alors enquête. Au terme de l’enquête, il doit se rendre à l’évidence, il est le coupable qu’il recherche : il y a identité du chercheur et du cherché ! De même, en cherchant les horcruxes qu’il faut détruire pour détruire Voldemort, Harry découvre qu’il est un des horcruxes qu’il faut détruire.
Le parallèle est léger, penserez-vous, mais revenons à Œdipe : au fil de son enquête, Œdipe découvre aussi qui il est, que Laïos était son père et qu’en épousant Jocaste, il a épousé sa mère. Autrement dit, ce qu’Œdipe explore, ce n’est pas seulement ce qu’un policier découvre en cherchant l’auteur d’un crime, c’est sa propre identité. Or Harry doit tout apprendre de ses parents, tout apprendre de lui-même. Au début du tome I, il ne sait même pas qu’ils étaient sorciers, il ne sait même pas qu’il l’est aussi. Il cherche d’abord du côté du père, auquel il s’identifie autant qu’il peut, via le quidditch, le patronus en forme de cerf, l’amitié que lui inspirent Lupin et Sirius. À la fin de l’ordre du Phénix, il découvre que son père était aussi un crétin malfaisant. Et le choc est violent, mais exemplaire. Comme disait Oscar Wilde : « Les enfants commencent par aimer leurs parents, puis ils les jugent. Il est rare qu’ils leur pardonnent. » Oscar faisait de la provocation : en général, les enfants pardonnent, mais ils doivent néanmoins faire passer en jugement leur enfance et leur famille et leur « culture » – qui n’est souvent que de la culture inculte, pas de la culture cultivée, mais des préjugés qu’on leur a mis dans la tête.
Compensation, un nouveau professeur apparaît dans le tome VI, c’est Slughorn, qui lui parle de sa mère avec une émotion intacte. Et ici je passe à Perceval le Gallois, le dernier héros de Chrétien de Troyes. La réaction de celui-ci, quand on lui apprend la mort de « la Veuve », c’est-à-dire de sa mère, m’intéresse. Il s’exclame en effet : « Mais puisque ma mère a été mise en terre, pourquoi irais-je chercher davantage, car je n’étais parti en quête que pour la revoir ? »
Revoir maman est le rêve impossible que Harry poursuit, jusqu’à ce qu’il accède à une interprétation meilleure de l’exemple qu’elle lui a laissé : le sacrifice, – le sens qu’elle a donné à sa vie et à sa mort. C’est cela qu’il doit imiter.

Le parallèle avec Perceval va plus loin : en effet, comme le héros de Chrétien, Harry doit établir son identité, en commençant par son nom et son lignage. Perceval ne se connaît d’abord d’autres noms que ceux qu’on lui donnait chez lui : Beau Fils, Beau Frère, Beau Seigneur. Il faut attendre trois mille vers pour qu’il prenne conscience de son nom et de lui-même : « Quel est votre nom, mon ami ? » lui demande sa cousine. « Et lui, qui ne connaissait pas son nom, le devina comme par enchantement et dit qu’il s’appelait Perceval le Gallois, sans être sûr de dire la vérité, mais il dit vrai, sans le savoir. »
Certes, J. K. Rowling déplace le problème. Perceval avait grandi dans l’ignorance de son nom et de sa naissance, jusqu’à ce qu’un chevalier lui révèle l’existence de l’héroïsme. Pour sa part, Harry ne doit pas découvrir un secret dans sa naissance, mais que ses parents ont été tués, et pourquoi, et pourquoi lui-même a failli l’être alors qu’il n’était qu’un bébé inoffensif. L’apparition d’Hagrid ne l’étonne pas moins que celle du chevalier n’avait étonné Perceval.
Sa filiation lui réserve quelques surprises. Dans Perceval, la Veuve se résignait à révéler à son fils tout ce qu’elle avait d’abord eu soin de lui cacher : leur lignage, la vie et la mort du père, vaillant chevalier tué au combat. Par Hagrid, Harry apprend qu’il est sorcier et que ses parents ont été assassinés ; et par sa tante Pétunia, que sa mère était née moldue alors que la magie est le plus souvent un don héréditaire. Parce qu’il parle la langue des serpents, il a peur d’être « l’héritier de Serpentard », et craint alors de trouver le Mal en soi-même. À treize ans, Harry se découvre un parrain ; à dix-sept, il devine qu’il est par les frères Peverell – les créateurs des reliques de la Mort – le cousin de Voldemort.
Harry affronte donc la question de l’origine. « Mais d’où venons-nous donc ? dit le roi (d’un conte de Voltaire). – Je n’en sais rien, dit le phénix. » Harry doit construire la réponse, qui dit en gros que ses parents ont été poursuivi parce qu’ils représentaient des valeurs ; qu’ils n’ont pas cherché le salut dans la fuite ou dans des compromissions, mais dans la lutte ; qu’ils ont sacrifié leur deux vies pour sauver la troisième, car il suffit presque d’en sauver une ou une poignée pour sauver le monde.
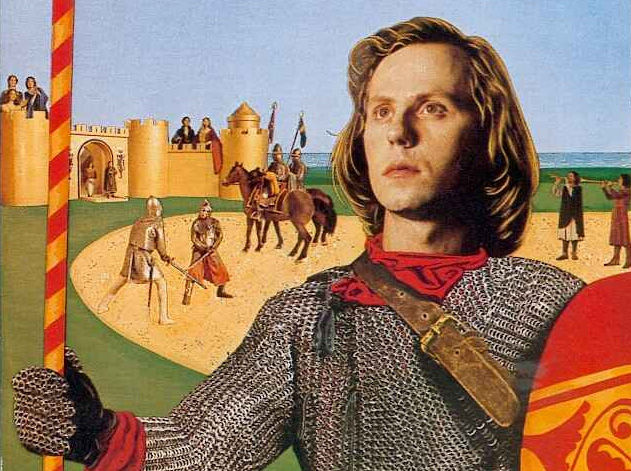
L’idée de sacrifice me mène à ce que J. K. Rowling fait des évangiles, – les quatre, cette fois : Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Harry Potter est construit sur le procédé de l’inclusion, qui consiste à commencer et finir un texte par le même mot, la même image. Le roman avait débuté avec Harry bébé dans les bras de Hagrid larmoyant et se mouchant. Il s’achève sur l’image du même bébé devenu jeune homme, reposant « mort » dans les bras du même géant, qui pleure encore ; – l’on songe alors à une pietà, par exemple celle de Michel-Ange, où la Vierge Marie reste plus grande que son fils. La boucle est bouclée, sauf que cette « mort » est aussitôt suivie d’une résurrection, – ce qui était déjà le cas dans les évangiles. Harry se relève après la Forêt interdite, comme le Christ après la Croix ; et il parle d’ailleurs de sacrifice. Pour les chrétiens, Jésus a vaincu la mort en créant les conditions de la vie éternelle ; Harry parle de tout autre chose : il parle de faire advenir, ici-bas, les conditions d’un vie réelle acceptable pour tout le monde.
Dieu est absent du roman de J. K. Rowling, parce que la politique est partout. Son roman ne nous dit pas pour qui il faut voter, dans la bande des On, – par ordre alphabétique, MM. Fillon, Hamon, Macron, Mélenchon. Elle ne nous dit pas ça, encore que son roman, via les Weasley, penche à gauche ; mais elle nous dit qu’il faut respecter les moldus et prendre soin des elfes ; elle nous dit que la presse ne fait pas bien son travail ; elle nous met en garde contre les pédagogues qui allègent les savoirs et suppriment le latin ; elle nous dit que la dictature et les attentats sont insupportables ; elle nous dit, avec Churchill, que la guerre est la seule bonne réponse à ce type de menace. Bref, elle met l’homme – la défense de l’humanité – au centre de sa création.
Ce faisant, elle rejoint Eschyle.
Retranscription de la conférence du samedi 4 février, à la médiathèque d'Ivry-sur-Seine.




















Comments