Projecteur sur... Les revues de l’été
- Antoine Stéphany
- 8 juil. 2016
- 4 min de lecture
L’été arrive, les vacances se profilent et, avec elles, la traditionnelle question : quelles lectures emmener dans sa valise ? Au lieu de conseiller un ou deux livres, nous aimerions vous encourager à (re)découvrir un format : la revue littéraire. Riches, les revues font voyager, rêver, découvrir, souvent autour d’un thème, d’un genre, d’une forme artistique… Coup de projecteur sur les revues littéraires, et les dernières qui nous ont marquées.

Une revue littéraire prend une forme proche du magazine. Publiée à un rythme (bi)mensuel, trimestriel, parfois (bi)annuel, elle rassemble différents auteurs et points de vue autour d’une même question, d’un même genre littéraire, d’auteurs partageant les mêmes principes et valeurs… Un fil conducteur, une particularité relient toujours les différents contenus d’une revue. Ainsi, fonctionne la revue Opium, publiée chaque année depuis 2013 par des étudiants de l’association Opium Philosophie ; elle rassemble des auteurs étudiants autour d’un thème, cette année la ville, pour introduire la philosophie dans la vie quotidienne, en prenant soin de mélanger les genres : textes, photographies, dessins… La revue Le Courage, qui a vu son deuxième numéro sortir au printemps dernier, rassemble quant à elle de jeunes auteurs prometteurs, dont l’œuvre commune forme un essai collectif dans le but de débattre, polémiquer, faire découvrir. Dirigée par Charles Dantzig et publiée chez Grasset, elle a cette année pour thème : les salauds.

De nombreux chercheurs se sont penchés sur les revues, leur rôle, leur histoire. Pour Bruno Curatolo et Jacques Poirier, elles ont au moins deux fonctions principales : en plus de servir de support aux historiens pour analyser la façon dont les auteurs rendent compte de leur époque, elle est aussi et surtout un lieu d’émergence de la création et des nouveaux auteurs. On l’a vu, cela fait partie de l’identité de la revue Le Courage, mais c’est aussi un but que l’on retrouve par exemple dans la revue IntranQu’îllités. De jeunes auteurs, encore jamais publiés, y côtoient de grands noms, Nancy Huston, Michel Onfray, Christiane Taubira, Dany Laferrière…
Comme le relève Paul Aron, l’intérêt d’une revue est double. Elle propose un ensemble de textes, de poèmes, d’œuvres artistiques ou littéraires que le lecteur peut découvrir au gré de son parcours au travers des pages de la revue : un poème de Gary Klang dans IntranQu’îllités, un court essai de Sandrine Treiner dans Le Courage, un texte de Hubert Haddad dans Apulée, etc. Mais, dans un second temps, une revue propose aussi un deuxième niveau de discours, c’est-à-dire une analyse de son objet, de sa démarche littéraire, de ses intentions en rassemblant les différents auteurs qu’elle met en scène. Par exemple, la revue Apulée, dont le premier numéro est sorti mi-février, articule ces textes autour d’un thème, l’identité, mais adopte un point de vue et une démarche résolument particulière : le rejet de l’ethnocentrisme.
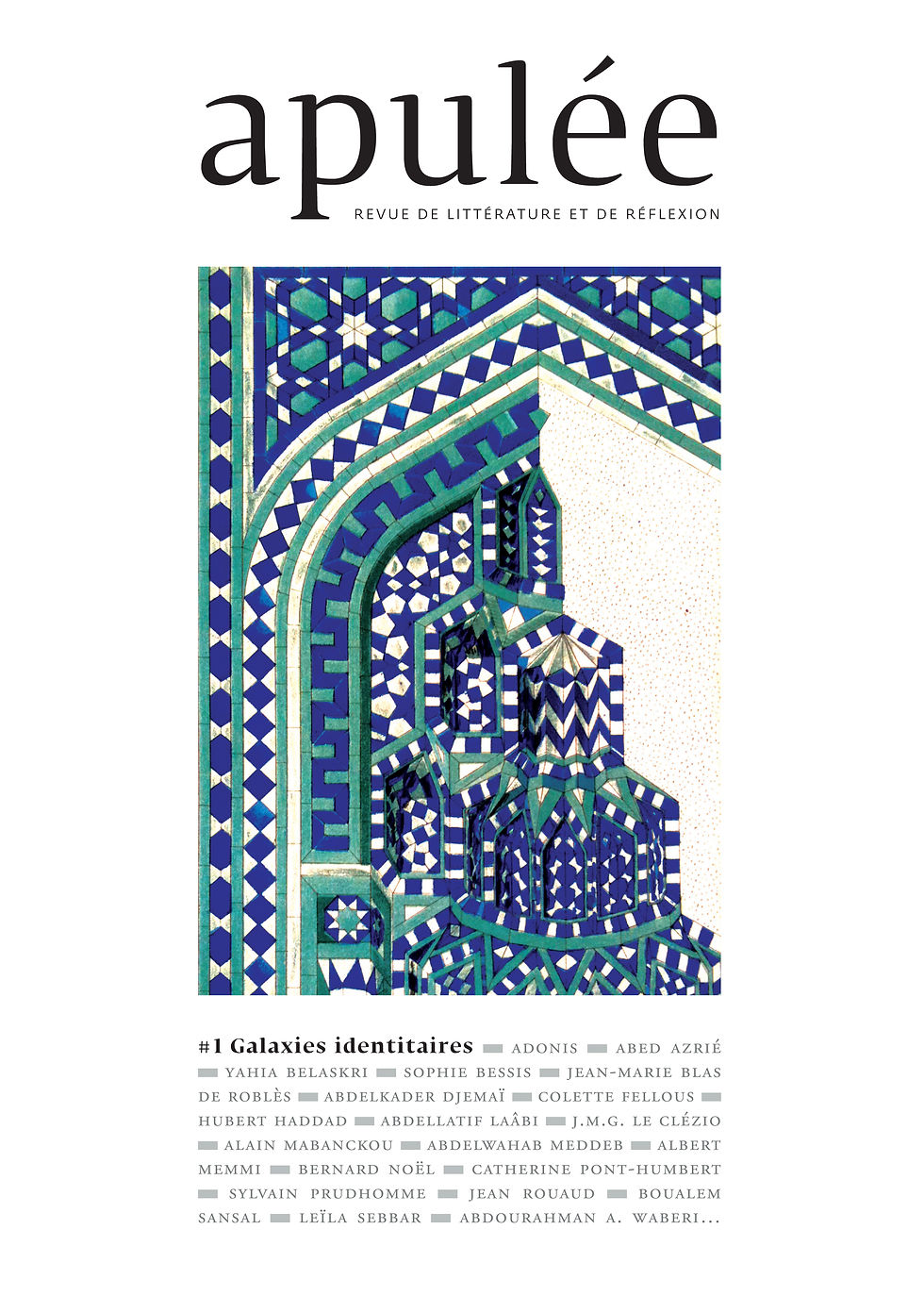
Mais une revue, c’est aussi (et surtout) un objet, travaillé, recherché, dont la mise en page est soigneusement étudiée, le papier minutieusement choisi, et rien n’y est laissé au hasard : police de caractères, illustrations (ou non), disposition du texte, couverture… En ce sens c’est un bel objet, comme il existe de beaux livres, et pas un simple recueil de textes accrochés les uns à la suite des autres. Quand on ouvre la revue Opium, la première chose qui frappe l’œil est la place accordée aux illustrations, à l’écho qu’elles font aux textes, toujours soigneusement agencées par de jeunes graphistes. En feuilletant IntranQu’îllités, on est saisi par la galerie de portraits qui, au lieu d’afficher le visage de chaque auteur, présente de magnifiques photographies de leurs mains, le plus grand outil des créateurs. Enfin, quand on prend Apulée en main, on ne peut qu’être surpris par la légèreté de cette revue de 400 pages, légèreté permise par la qualité du papier.
Revenons un peu dans le temps : à quand remontent les premières revues ? Elles sont apparues en France dans la première moitié du xixème siècle. Une des plus ancienne, et toujours en activité, la Revue des deux Mondes, est née en 1829 ; elle proposait à ses débuts un contenu tourné autour de la littérature, accueillant de grands écrivains du XIXème, Balzac, Dumas, Baudelaire, avant de s’orienter progressivement vers un contenu plus politique et économique. C’est aussi au xixème siècle que la Revue des Belles-Lettres a commencé, qui perdure encore aujourd’hui, avec une forte dominante poétique, Mais l’âge d’or des revues fut évidemment le xxème siècle, avec la très célèbre Nouvelle Revue Française (NRF), publiée pour la première fois en 1908, et éditée dès 1911 par Gaston Gallimard. Elles se sont ensuite multipliées et diversifiée tout au long du xxème siècle.
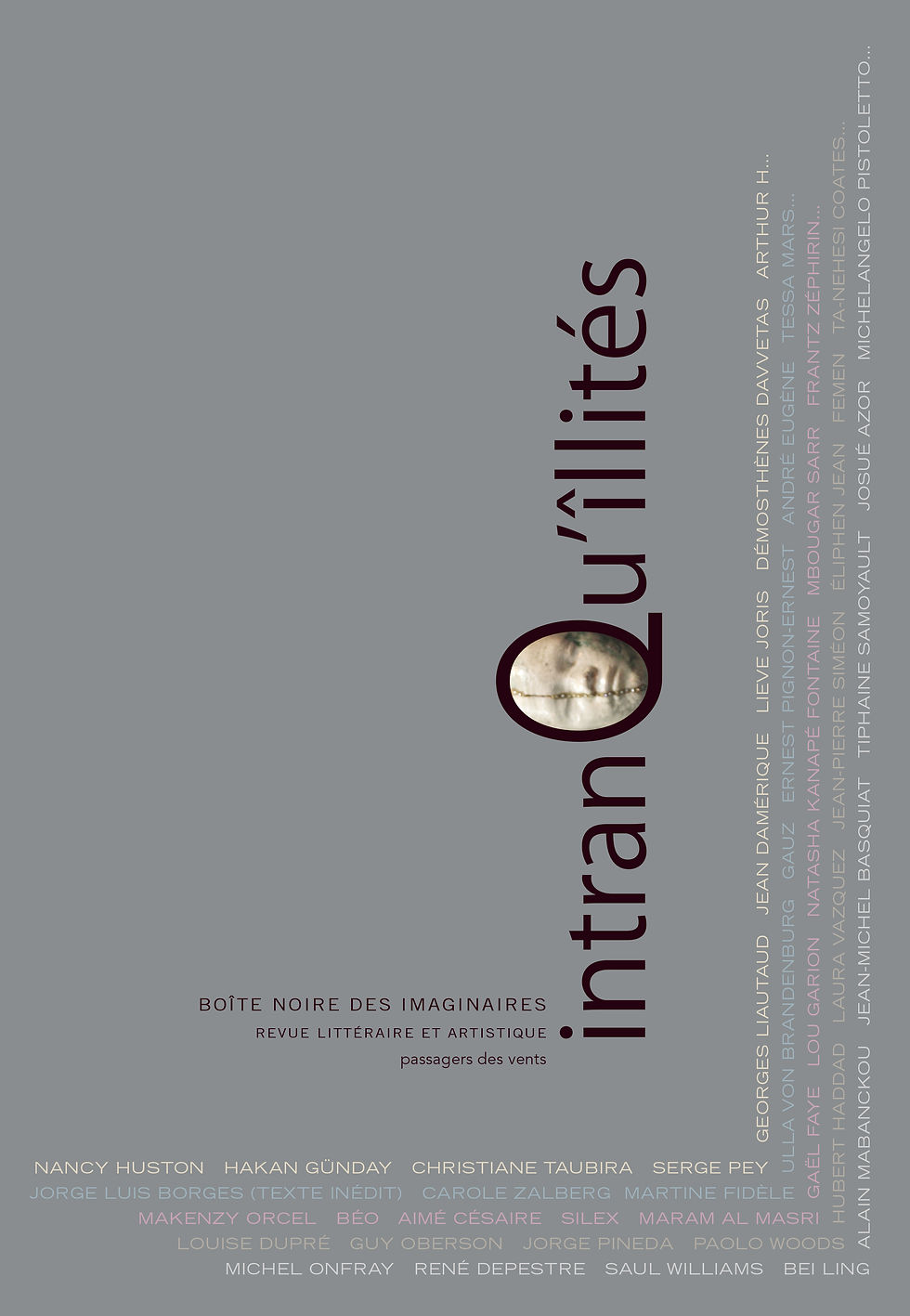
Mais aujourd’hui, quelle place pour les revues ? Si le format de la revue continue d’exister deux siècles après sa naissance, et se centre autour de thèmes de plus en plus variés, certains considèrent que leur âge d’or est aujourd’hui terminé. Néanmoins, cela n’empêche pas nombre de collectifs et d’éditeurs de créer des revues autour de thématiques encore inexplorées, dans des formes toujours plus variées, internationales – Le Courage propose des textes du monde entier en langue originale, tout comme IntranQu’îllités et Apulée.
Les revues sont une belle invitation à la découverte d’un thème, une formidable aventure pleine de débats, de poésie, d’art, de contradictions, d’évasion… Les quelques exemples présentés ici sont ceux qui nous ont le plus touchés ; nous espérons que vous aurez l’envie de découvrir l’une (ou plusieurs !) d’entre elles, et l’embarquerez avec vous dans vos escapades estivales.




















Commentaires