Pourquoi faut-il lire... Ann
- Edgar Dubourg
- 18 avr. 2016
- 4 min de lecture
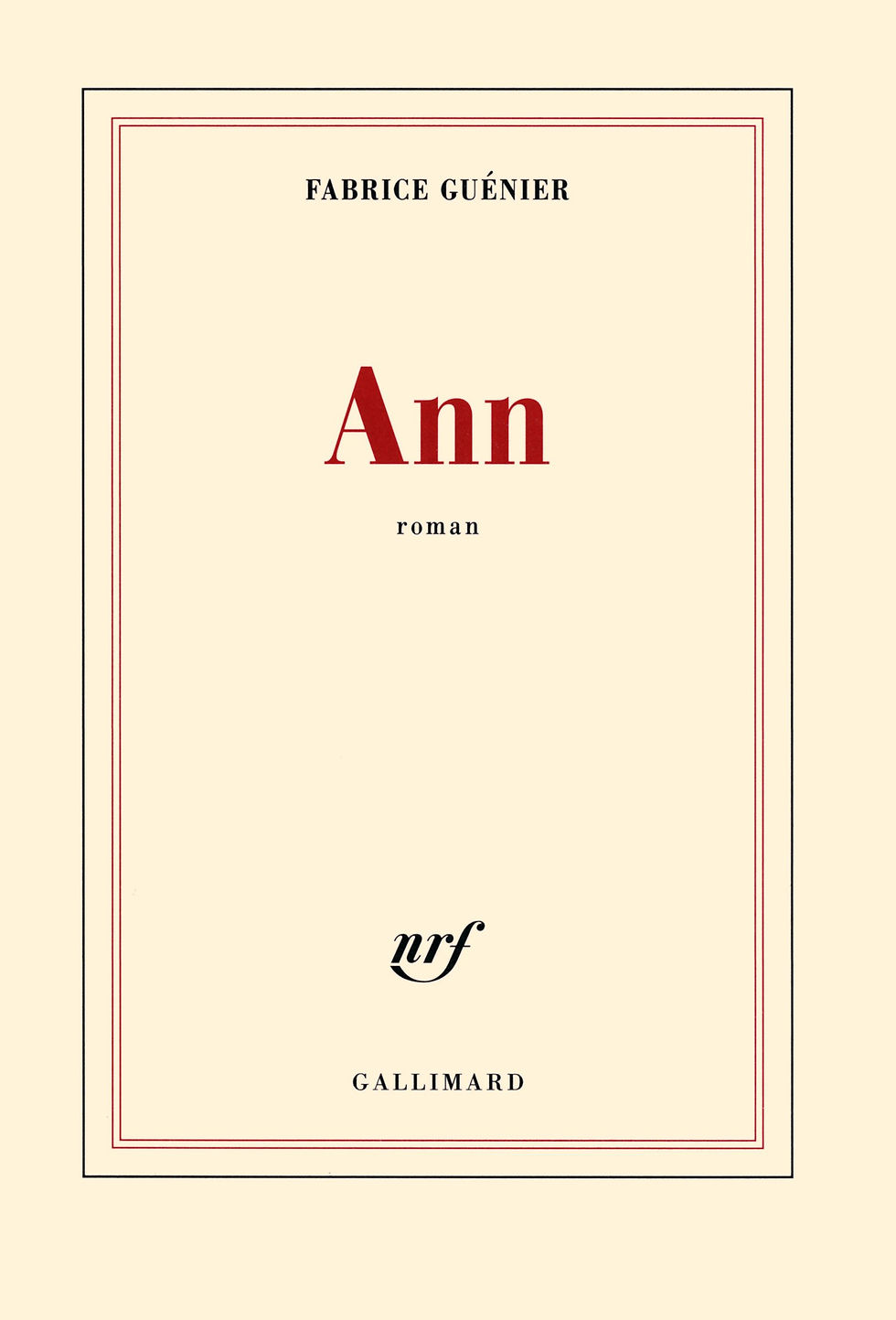
On se demande, parfois, ce qui fait qu'on plonge dans une histoire – le terme qu'on utilise, plonger, est d'ailleurs révélateur de ce que procure la lecture et la littérature : une sensation de se fondre dans une autre réalité, de disparaître pour mieux se retrouver, bref, une sensation de vivre. On se demande, parfois, quel est le moment précis quand l'on plonge dans l’histoire, on cherche la page qui fait tout basculer, la phrase qui a conquis nos sens et qui nous a aspiré dans l’écriture et le récit. Parfois, on se demande si on est vraiment rentré dedans, c’est-à-dire si l’on n’est pas resté à la lisière du roman, en simple spectateur : on a tout simplement pas plongé.
Ce n’est pas du tout le cas du roman dont je vais parler.
Je me pose ces deux questions – quand l’histoire et l’écriture m’ont-elles attrapé, et pourquoi à ce moment précis tout a-t-il basculé –, à chaque livre, ou presque. Pour Ann, la question, du moment qui m’a précipité dans le roman ne s’est pas posée : c’est la toute première phrase.
« Emmène-moi dans le passé. »
Et je me suis senti emmené. J’étais pris. J’étais déjà dans cette réalité parallèle que créé la lecture et qui fait surgir un étrange mélange d’émotions, d’images, de sensations de vérités.
La deuxième question, celle du pourquoi, est toujours difficile, car la littérature est une succession de mots que ne peuvent pas toujours expliquer les analyses rationnelles. On peut tenter des ébauches de réponses : dans le cas de Ann, des phrases courtes, un rythme scandé, une respiration juste… Je me suis laissé bercé par la poésie des tournures à la fois sèches et raffinées.
Voilà la première page :
« Tu es morte.
C'est plat. C'est cru. C'est net.
Il n'y a pas eu d'envolées d'orgues ni de ciel d'orage. La campagne a continué de crépiter sous le ciel bleu, le riz de sécher, les poules de caqueter. Les enfants criaient dehors.
Le monde ne s'arrêtait pas. Toi seul partais.
Il y a l'instant d'avant et celui d'après. Et tous ceux qui vont suivre, à demi inutiles. À demi et plus.
[…]
J'ai avalé un sac de ciment. Pour l’instant, encore mouillé de larmes, mais qui se solidifiera.
J'ai avalé un sac de ciment.
Pour l'instant, il me noie, sous la forme d’une coulée de boue grise qui bloque, empêche la respiration. Du ciment trempé de larmes. Mais je sais qu'il séchera, durcira. Me tapissera intérieurement pour longtemps. »
S'en suit un roman d’amour – la rencontre, l'échange, les regards –, qui tourne en drame attendu – la maladie, la mort, le deuil –, et qui laisse une sensation forte de vraie mélancolie, dans sa forme la plus concrète, la plus dure ; car c’est un roman qui parle d'abord de solitude. Ce récit dont le souffle est grave est tout du long comme cette première page : l’auteur va à l’essentiel, dit les choses telles qu'elles sont avec une apparente objectivité qui bouleverse, qui passe pour de la froideur. C’est un livre qui se lit en apnée, car on souffre et on pleure avec le personnage, et les pages paraissent trop courtes, les silences trop brefs.
De cette première page, je suis ressorti bouleversé. La première phrase donne le ton : c’est une information cruciale et brute – ce que l’auteur explique ensuite : « C’est plat. C’est cru. C’est net. » Une anaphore rythmée, lacunaire, qui rend extrêmement bien compte de la brutalité de la mort, de la perte d’un être cher. Le paragraphe suivant donne la sensation du temps qui passe et s'arrête, cette ambivalence si caractéristique de ces moments de flous qui suivent l’irréparable. Il y a beaucoup de belles trouvailles dans ce court paragraphe : ne pas essayer de dire ce qui se passe, mais plutôt dire ce qui ne s'est pas passé (« Il n’y a pas eu d’envolées d’orgue ni de ciel d’orage ») ; utiliser, non pas l’imparfait, mais le passé composé avec le verbe « continuer » (« La campagne a continué de crépiter […]), pour insister à la fois sur l’instantanéité du choc et la permanence de la sensation d’incompréhension ; les répétitions de mots (« ciel », « à demi ») ou de phrases (« J’ai avalé un sac de ciment ») ; l'utilisation du futur pour montrer la lucidité et la résignation du narrateur, qui sait que la douleur sera à jamais insoutenable.
Voilà quelques indices pour tenter de comprendre ce magnifique incipit, qui inaugure un roman bouleversant. Et pourtant, le défi était de taille : écrire 300 pages ou presque sur la mort d’une femme est périlleux. Le narrateur le sais :
« Écrire sur le vide que tu laisses, c’est un peu un leurre, un peu vain, mais comme je te parle tout le temps ça structure un peu. C’est une autre façon de te parler. Autrement que les yeux embués, debout face à la forêt, dans la nuit ou dans la journée, ou dans les allées d’un Seven, ou roulant sur la route sous le soleil, ou devant ta penderie, ou serrant ta robe. Ou partout en fait.
Je sais que je parlerai longtemps. Partout. Devant les choses que tu as vues, parce que tu les auras vues, ou devant celles que tu n’auras pas vues, parce que tu ne les auras pas vues.
Je sais que je te parlerai toujours dans ma tête, avec des mots très bêtes, des mots très convenus.
Les mots des pauvres gens.
Des mots pour que tu reviennes. »
Ce qui permet de continuer à lire, malgré le sujet du roman qui aurait pu le rendre tout simplement insoutenable, c’est la poésie, la justesse dans l’écriture ; ce sont justement ces mots « bêtes » et « convenus », très précis en fait, qui permettent de traverser le récit – comme je l’ai dis en apnée : on a bien plongé. Une traversée dont on ne ressort certainement pas indemne.
Ann, Fabrice Guénier (Gallimard)




















Comments