Pourquoi faut-il lire... La vie en cinquante minutes
- Edgar Dubourg
- 14 mars 2016
- 3 min de lecture
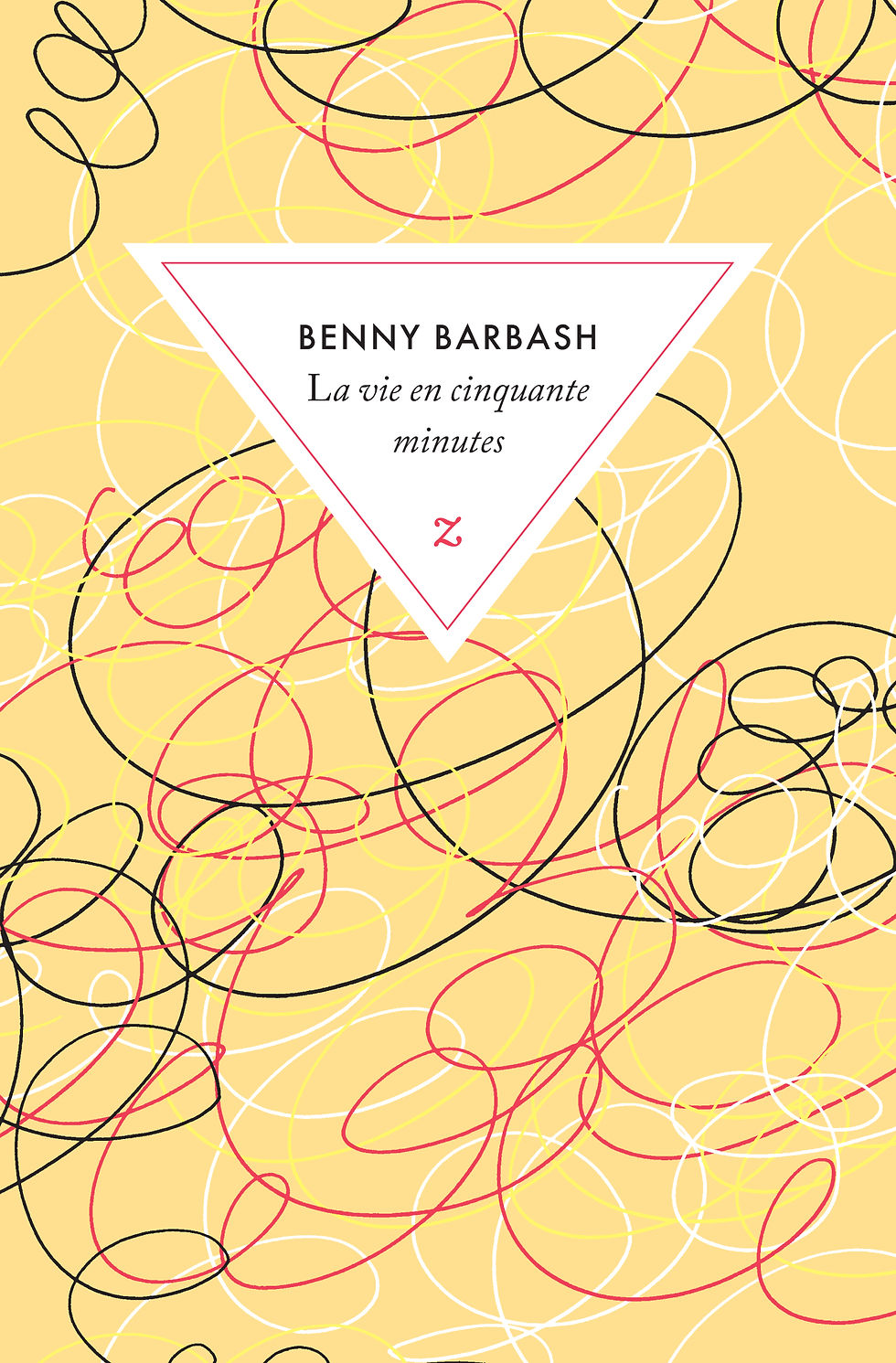
C’est un roman à la fois drôle, intelligent et révélateur que signe Benny Barbash – révélateur des sentiments humains qui animent nos gestes, qui font nos paroles, qui guident nos réactions, des plus pathétiques aux plus formidables. Une femme, épouse et mère de famille, découvre un cheveu blond entortillé autour de la bretelle du maillot de corps de son mari, et devient jalouse et paranoïaque, s’obligeant à rechercher des preuves de l’infidélité de son mari ; c’est le début d’une aventure extraordinaire qui fera revenir de loin le raz-de-marée des souvenirs. Le personnage de cette femme, Zahava, s’établit sous nos yeux comme on construit un puzzle : on pense savoir d’avance l’image que le puzzle rendra une fois terminé, mais ce n’est qu’après avoir posé la dernière pièce que l’on appréhende la totalité du tableau : Zahava nous raconte une vie qui nous échappe en permanence, et dont on comprend les arcanes qu’aux dernières pages du livre. Assise sur le divan de son thérapeute :
« Étendue sur le dos, elle se sentait exposée, sans défense et au lieu de se concentrer sur les raisons mêmes qui l’avaient poussée à consulter une analyste, elle s’égarait dans des considérations secondaires : pourquoi faut-il être étendue sur le dos ? En quoi cette position favorise-t-elle la thérapie ? Pourquoi le divan est-il si dur ? Pour empêcher les patients de s’endormir ? »
Zahava se lance, après la découverte du cheveu, dans une quête d’indices qui la mènera à tenir un revolver, à engager un détective, à se déguiser, à inventer des histoires d’invasions d’araignées. L’obsession et l’imagination sont les deux seuls moteurs de cette enquête tournée en dérision de mille façons. L’intelligence du récit est sa construction : une somme inégalable de digressions qui finissent, paradoxalement, par devenir essentielles ; des anecdotes qui se recoupent, qui se rejoignent, se finissent puis recommencent ; des scènes imaginées par Zahava, avec des « si » qui pourraient, par la puissance révélatrice de ces multiples anticipations, mettre Paris en bouteille ; un livre, finalement, construit comme un jeu de piste, et dans lequel le lecteur se fait sa propre histoire. La jalousie, dont l’objet « se trouve doté du pouvoir perdu par celui qui l’éprouve », va alors prendre des formes et des visages improbables :
« Au fait, quand s’était-elle fait teindre les cheveux ? demanda-t-elle à son ami dans le taxi. Ça me va, n’est-ce pas ? dit la physicienne en agitant coquettement ses boucles blondes. Impressionnant, dit Zahava tout en se retenant de ne pas arracher comme par mégarde un cheveu de sa tête pour le comparer à celui qu’elle avait rangé dans un dossier. »
Ce qu’il y a d’exceptionnel, c’est que cette histoire aux rebondissements multiples, aux détours et aux digressions géniales, est pensée par Zahava en cinquante minutes, le temps de sa séance de thérapie durant laquelle elle reste muette. C’est dans ce silence qu’elle revient sur cette aventure, sur sa vie, sur chaque fait et chaque geste qui l’ont menée à ces questions sans réponse ; et ce retour en arrière jalonné de souvenirs plus ou moins lointains, est également recoupé de considérations et de réflexions présentes, avec le recul nécessaire sur son existence.
« Aujourd’hui, je vais parler, se répéta-t-elle, essayant de surmonter son angoisse. Je vais tout déballer. Je vais vomir tout le poison que le silence instille dans mon sang depuis des années. Je n’ai pas le choix, c'est l’occasion ou jamais de faire échouer le plan démentiel qui a mûri dans ma tête et dont l’accomplissement serait une catastrophe. Ils sont déjà au bout de ma langue, là où ils se rassemblent pour se déverser sur le monde. »
C’est le début du livre ; la suite est celle de l’histoire de ce « plan démentiel », de l’évolution, des raisons, de la source de ce dernier. Pourtant, on apprendra vite que Zahava ne cherchait pas vraiment les preuves de la culpabilité de son mari ; elle se cherchait, elle-même. Ce récit, aux limites du tragique, est celui d’une femme qui tente de se retrouver, et qui n’y arrive jamais.
La vie en cinquantes minutes, Benny Barbash (traduit de l'hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech, Zulma)




















Comentarios