Pourquoi faut-il lire... En finir avec Eddy Bellegueule
- Antoine Stéphany
- 4 janv. 2016
- 2 min de lecture
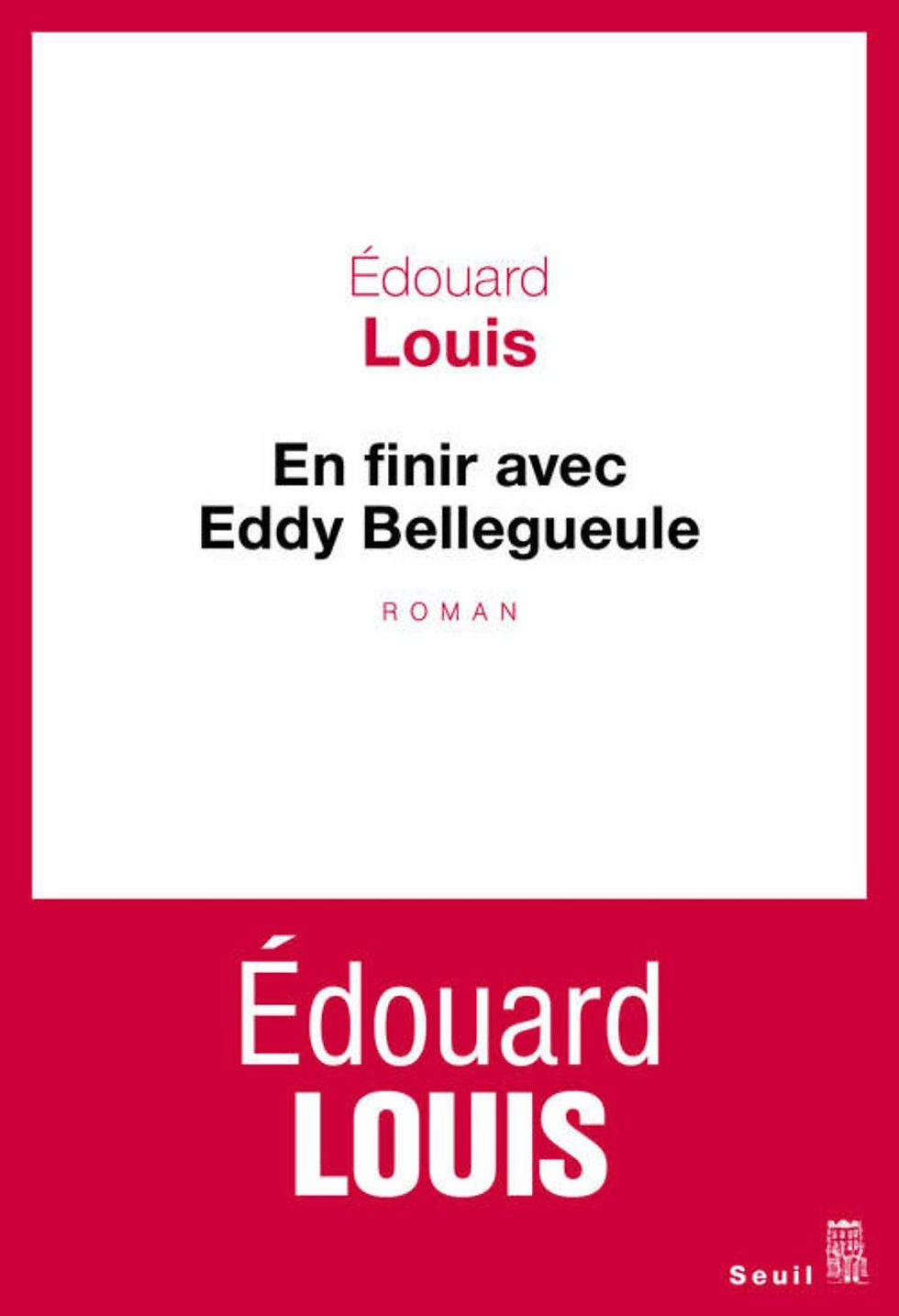
En finir avec Eddy Bellegueule est plus qu’un simple roman autobiographique. Edouard Louis n’y raconte pas seulement son histoire, l’enfance d’un garçon homosexuel, mais aussi celle d’un village, d’une région, d’un milieu social, celui des ouvriers dans un village de la Somme. Dès les premières lignes, le ton est donné :
« De mon enfance je n’ai aucun souvenir heureux. Je ne veux pas dire que jamais, durant ces années, je n’ai éprouvé de sentiment de bonheur ou de joie. Simplement la souffrance est totalitaire : tout ce qui n’entre pas dans son système, elle le fait disparaître ».
En finir avec Eddy Bellegueule fait le récit de la jeunesse de l’auteur, collégien homosexuel se décrivant comme maniéré, dans ce milieu ouvrier rural, où violence et domination de classe sont intimement liées. Cette violence, il la retrouve au quotidien, que ce soit à travers les persécutions des autres collégiens ou les remarques de sa famille. A cette peinture détaillée d’un milieu social et de son homophobie latente, s’ajoute un récit extrêmement intime et physique, que ce soit dans la description de la violence quotidiennement subie ou d’une sexualité à peine découverte. Car pour Eddy, à l’origine de tout cela, il y a son corps, maigre et incontrôlé, un corps qui le trahit :
« Mes parents appelaient ça des airs, ils me disaient Arrête avec tes airs. Ils s’interrogent Pourquoi Eddy il se comporte comme une gonzesse. Ils m’enjoignaient : Calme-toi, tu peux pas arrêter avec tes grands gestes de folles. Ils pensaient que j’avais fait le choix d’être efféminé, comme une esthétique de moi-même que j’aurais poursuivie pour leur déplaire ».
Mais ce qui fait peut-être la plus grande réussite de ce roman, c’est la façon dont l’auteur retranscrit les deux niveaux de langage qui le traversent perpétuellement. Ceux-ci s’entremêlent, le narrateur étant tiraillé entre la langue populaire de son enfance, symbole de domination, et un français plus cultivé, littéraire, celui acquis par l’éducation. Le rythme est ininterrompu, la narration fluide, et l’enchevêtrement de ces deux langues à l’intérieur même de chaque phrase rend compte du conflit perpétuel qui traverse l’auteur, entre regard extérieur porté sur son passé et enfance vécue de l’intérieur comme malheureuse. Mais toujours, une expression simple, où la violence est omniprésente :
« Il les faisait beaucoup rire – toujours les rires – à chacune de ses prises de parole Ah ! Celui-là il fait du vélo sans selle. J’aimerais pas ramasser la savonnette à côté de lui. Lui, pédé ? Plutôt se faire enculer. L’humour qui à certains moments cédait la place au dégoût Faut les pendre ces sales pédés, ou leur enfoncer une barre de fer dans le cul ».
Rien n’est en trop, rien n’est laissé au hasard. En définitive, la langue sert avec une incroyable acuité le récit, et nourrit tout du long ce qui est, pour moi, l’ambiguïté centrale de ce roman, qui en fait toute sa beauté : c’est de comprendre comment la littérature, alors qu’elle est construite, travaillée, fictionnelle, peut conduire à saisir une vérité sociale qui n’est pas perceptible au premier abord. Edouard Louis fait le pari risqué de se prendre lui-même comme objet sociologique. C’est selon moi un pari réussi.




















Commentaires