Explorons en profondeur... Les liens entre Histoire et Littérature
- Chloé d'Arcy
- 2 févr. 2016
- 19 min de lecture
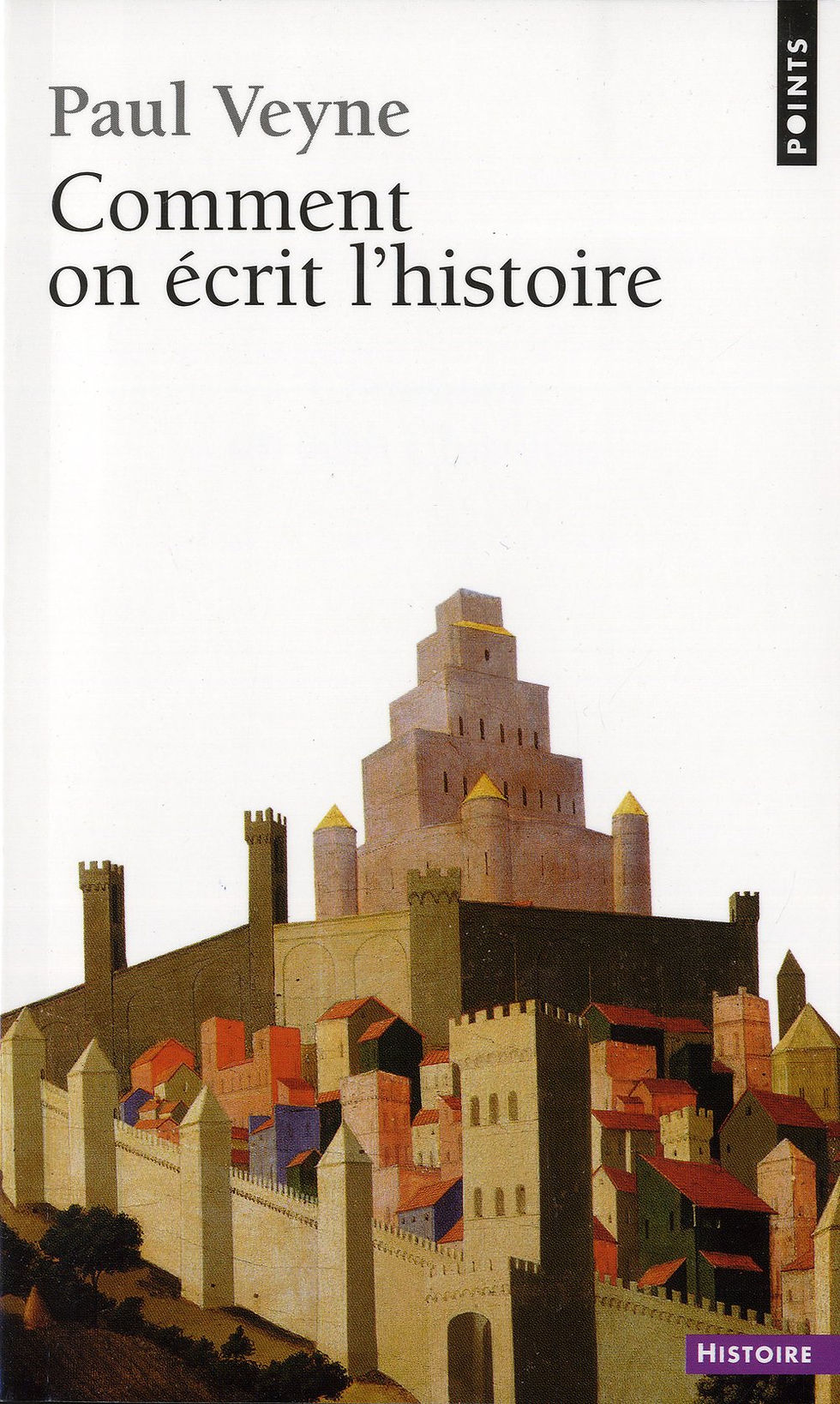
« Les historiens racontent des événements vrais qui ont l’homme pour acteur ; l’histoire est un roman vrai » écrit l’historien Paul Veyne (VEYNE, 1971 : 10). Son propos nous amène à envisager, ou plutôt à réenvisager, les liens qu’entretiennent l’histoire, discipline traditionnellement rangée parmi les sciences sociales, et la littérature, soit « les œuvres écrites, dans la mesure où elles portent la marque de préoccupations esthétiques ; les connaissances, les activités qui s’y rapportent […] Le travail, l’art de l’écrivain […] Ce qu’on ne trouve guère que dans les œuvres littéraires (par opposition à la réalité) – Ce qui est artificiel, peu sincère » (Le Nouveau Petit Robert de la langue française, 2008). Ces rapports se manifestent sous diverses formes, à travers par exemple l’écriture de l’histoire, l’histoire comme source d’inspiration littéraire, l’histoire littéraire, ou encore les œuvres littéraires (romans, poèmes, essais mais également témoignages et mémoires) comme sources pour l’historien.
Cette phrase de P. Veyne nous invite ici à nous demander si l’on peut considérer l’histoire comme un genre littéraire et plus particulièrement un sous genre romanesque. A côtés des romans historiques et policiers, il y aurait les romans vrais, et ces romans seraient produits par les historiens. Pourtant ces deux termes semblent antithétiques : le roman peut être défini simplement comme « une œuvre d’imagination en prose, assez longue, qui présente et fait vivre dans milieu des personnages donnés comme réels, fait connaître leur psychologie, leur destin, leurs aventures », c’est un récit fictionnel, la fiction étant le contraire du vrai, soit contraire à ce qui est « conforme au réel », « qui existe en fait, dans les faits » « qui n’est pas une illusion » (Le Nouveau Petit Robert de la langue française, 2008). Il semble de plus difficile d’associer l’histoire à la fiction puisque celle-ci est censée être « [la] connaissance et [le] récit des événements du passé, des faits relatifs à l’évolution de l’humanité (d’un groupe social, d’une activité humaine) qui sont dignes ou jugés dignes de mémoire […] étude scientifique d’une évolution, d’un passé » (Le Nouveau Petit Robert de la langue française, 2008) et retranscrire donc la vérité, ou du moins une vérité sur le passé, en se basant sur une méthode visant à prouver véracité de chaque élément énoncé. L’historien Pierre Nora a mis en évidence ce paradoxe de départ :
« Par principe, les deux genres sont irréductiblement séparés et s’opposent même radicalement. […] le roman ne relève que de la pure imagination […] il n’obéit […] qu’à l’invention personnelle de l’auteur et à son pouvoir de créer et d’animer un monde. L’histoire est habitée, au contraire, par une ambition de connaissance de plus en plus scientifique de tout le passé humain dans sa diversité et sa complexité, exploré grâce à des traces interprétées. » (NORA, 2011)
Néanmoins, on note qu’il est question de « récit » à la fois dans les romans et dans la transcription de l’histoire. Ainsi, s’interroger sur les liens entre histoire et littérature amène à s’interroger sur la pratique de l’écriture de l’histoire et ses proximités avec la littérature. Par ailleurs, si l’histoire est un roman « vrai », nous devons également nous pencher sur le cas du roman historique,
« […] fiction qui emprunte à l’histoire une partie au moins de son contenu. Plus spécifiquement, on dira que le roman historique "prétend donner une image fidèle d’un passé précis, par l’intermédiaire d’une fiction mettant en scène des comportements, des mentalités, éventuellement des personnages réellement historiques" (Madalénat, 1987 : 2136) » (GENGEMBRE, 2006 : 87),
aussi bien le roman historique dit « classique » du XIX° siècle que le roman historique contemporain, certains ayant dans les années 2000 ranimé avec force le débat sur la frontière entre littérature et histoire. Il s’agira donc de confronter le récit historique au roman historique, leurs différences, leur complémentarité peut-être à travers l’étude des connaissances spécifiques que ces romans peuvent produire tout en s’interrogeant sur la nature de « la vérité » établie par l’histoire.
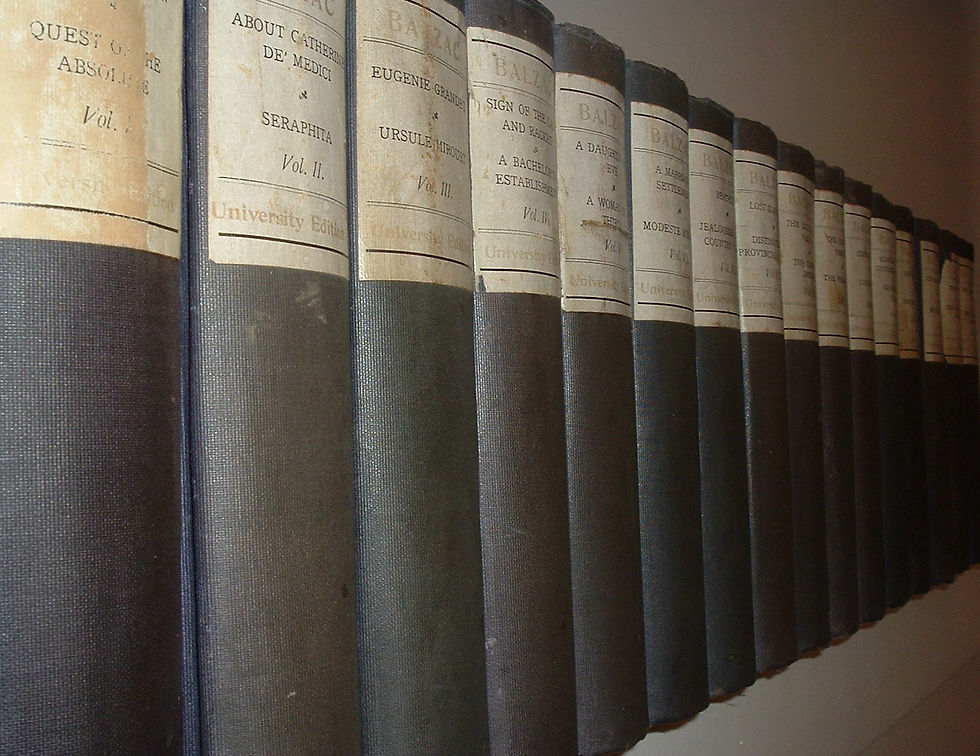
Les débats sur la frontière entre littérature et histoire réanimés par la parution récente de romans historiques sur la Shoah ont également invité les historiens et les littéraires à s’interroger sur les origines de l’histoire et sa proximité indéniable avec la littérature. En effet au début du XIXème siècle encore, la discipline historique était considérée comme un sous-genre littéraire comme l’explique Madame de Staël dans De la littérature paru en 1800.
C’est à cette période que naissent les romans historiques dits « classiques » avec Walter Scott dans le monde anglo-saxon et le courant romantique en France à travers par exemple la figure d’Alexandre Dumas qui énonçait : « Notre prétention en faisant du roman historique est non seulement d’amuser une classe de nos lecteurs, qui sait, mais encore d’instruire une autre qui ne sait pas, et c’est pour celle-là particulièrement que nous écrivons ». Le roman réaliste, en déplaçant seulement la période étudiée, propose lui aussi de véritables techniques d’enquêtes, basées sur l’observation et la documentation préfigurant le travail de l’historien. Ivan Jablonka, historien et écrivain, énonce en 2014 à propos du travail de Balzac : « Non seulement l’écrivain fait un travail plus difficile que l’historien, mais ses romans sont authentiques, plus démonstratifs, plus vrais en somme » (JABLONKA, 2014 : 68) Pour lui, ce sont véritablement les romanciers du XIXe siècle qui ont donné un nouveau souffle à l’histoire :

« Bien sûr, Scott invente, contrairement aux historiens. Mais la grande leçon, pour ces derniers, est de constater que ses romances font basculer dans le faux les éruditions des anciens maîtres : ils comportent plus de vérité que l’Histoire elle-même […] l’impact de Châteaubriand et de Scott n’est pas uniquement "littéraire". L’apport de leurs œuvres ne se résume pas à la résurrection du passé, ni à la couleur locale. Ce que les historiens libéraux renouvellent au contact des romans, ce n’est pas seulement leur art d’écrire ; c’est aussi leur méthode » (JABLONKA, 2014 : 52-53).
Un exemple anecdotique mais assez marquant de la méthode employée par le roman et transférée à l’histoire est celui des notes de bas de page : caractéristiques d’un ouvrage d’historien à présent, elles étaient au départ utilisées par les romanciers pour prouver la véracité des faits qu’ils énonçaient. En outre d’après Gérard Gengembre, professeur de littérature et spécialiste du roman historique, dans le cas de Balzac ou de Dumas, « l’imaginaire est accoucheur de vérité. Le roman se donne donc comme un leurre pour piéger l’histoire, la rendre vivante et compréhensible » (GENGEMBRE, 2010). Ainsi la compréhension étant essentielle à la diffusion de connaissances, le roman, et donc la littérature, semblait davantage remplir au XIXe siècle les fonctions que l’on associe aujourd’hui à l’histoire.
Les historiens de l’époque sont eux aussi fortement imprégnés par le côté littéraire de leur discipline en ce qui concerne son écriture et la dimension esthétique associée à la littérature. L’exemple le plus célèbre est certainement celui de Jules Michelet, davantage lu aujourd’hui pour la beauté de son style que pour la scientificité de ses travaux, proposant une histoire fortement romancée, influencée par le courant romantique. « Pour Jules Michelet, l’histoire est production de vérité, et c’est ce qui fonde l’importance de l’écrire » (SEGINGER, 2005 : 17). On remarque en tout cas que la préoccupation de retranscrire la vérité est centrale lorsque l’on touche à l’histoire, le détour par la fiction (n’excluant pas un travail méthodologique de documentation destiné à prouver la véracité des faits énoncés) étant à l’époque le moyen le plus à même de rendre compte de la vérité et une écriture littéraire aidant à son expression et donc à sa compréhension par le lecteur. C’est la « puissance d’une écriture qui fait de la cohérence une manifestation de la vérité historique » (SENINGER 2005 : 6).
Pourtant à la fin du XIX° siècle et notamment sous la III° République, l’histoire se constitue comme une discipline autonome, en rupture avec la littérature, en raison entre autres de la naissance de la sociologie concurrente, basée sur une méthode rigoureuse, avec la volonté d’avoir de s’imposer comme une science. « L’adieu à la littérature a permis à l’histoire de conquérir son autonomie intellectuelle et institutionnelle » (JABLONKA, 2014 : 96). C’est un coup dur porté à la littérature, en quelques sortes méprisée par les historiens : voir son travail qualifié de « littéraire » est une critique sévère. Les origines romanesques de l’histoire sont totalement reniées. L’écriture même, pouvant par son esthétique rapprocher l’histoire de la littérature, est fortement encadrée : elle n’est que la touche finale de l’historien dont le talent doit rester confiné dans les règles strictes de la profession. « Désormais, le non texte est gage de scientificité. Etre objectif, c’est non-écrire. » (JABLONKA, 2014 : 96). Cette perspective dominera longtemps l’historiographie française, poursuivie par l’école des Annales accordant une large place à la scientificité historique et à l’usage des techniques quantitatives.
A partir des années 1970, avec le déclin de l’influence marxiste, la dimension littéraire de l’histoire, dans les réflexions qu’elle suggère ainsi que dans son acceptation et dans l’usage qu’en font les historiens, revient sur le devant de la scène. Elle est d’abord réexprimée de façon brutale par le courant du Linguistic turn anglo-saxon :
« Née dans les années 60, une école philosophico-sociologico-psychanalytico-littéraire s’applique, sans toujours le proclamer, à effacer la frontière entre histoire et fiction, en traitant la première comme si elle ne différait pas de la seconde. Dans cette perspective fictionnaliste, l’histoire est une branche de la rhétorique : elle n’a qu’une dimension qui est celle de l’écriture et les procédés mis en œuvre par les historiens prétendument pour rendre leurs affirmations contrôlables n’ont en fait pour seul rôle que de faire croire le lecteur à la véracité des récits qu’ils lui proposent. » (POMIAN, 1989)
Ce point de vue un peu extrême dérange les historiens.
« L’histoire, devenue composition, artifice, "fiction verbale", n’a plus aucun régime cognitif propre. C’est ainsi que le Linguistic turn tente de ruiner l’histoire en lui déniant toute capacité à dire, davantage qu’une fiction, le vrai. » (JABLONKA, 2014 : 106)
De tels discours, réfutant toute vérité historique en ne présentant l’histoire que comme une fiction basée sur des sources qui sont uniquement des représentations de la réalité, peuvent en effet venir soutenir les thèses négationnistes naissantes. Néanmoins ce tournant invite les historiens à s’interroger sur les origines de leur discipline d’une part, et sur la façon dont ils la pratiquent d’autre part, avec la question centrale de l’écriture de l’histoire. C’est le cas notamment de Paul Veyne, Michel de Certeau et Paul Ricœur en France.
P. Veyne par exemple, comme nous l’avons mentionné, pose le postulat que « l’histoire est un roman vrai » (VEYNE, 1971 : 14), acceptant donc totalement la dimension littéraire de l’histoire sans pour autant tomber dans les travers du Linguistic turn. « Comme le roman, l’histoire trie, simplifie, organise, fait tenir un siècle et une page et cette synthèse du récit est non moins spontanée que celle de notre mémoire » (VEYNE, 1971 : 25). Il rejette même l’idée de méthode propre à l’histoire puisque celle-ci « n’a aucune exigence : du moment qu’on raconte des choses vraies, elle est satisfaite. Elle ne cherche que la vérité, en quoi elle n’est pas la science, qui cherche la rigueur ». Comme le roman, c’est en racontant que l’histoire explique, ces deux dimensions s’enrichissant mutuellement. Pour rendre compte de la vérité, l’historien doit rendre le plus compréhensible son propos et doit agir pour cela du mieux qu’il peut, n’ayant que sa plume pour cela. Les propos de P. Veyne sont légèrement provocants puisque s’il refuse de reconnaître l’existence explicitement d’une méthode historienne, il ne renie pas le travail sur sources de l’historien pour rendre compte de la réalité.
Dans la même perspective, I. Jablonka affirme lui aussi que « l’histoire est une littérature contemporaine » mais se désolidarise toutefois de l’expression « roman vrai » :
« Si l’histoire est littérature, ce n’est pas par sa forme romanesque. En revanche, je pense que les sciences sociales pratiquent des fictions assumées, que j’appelle "fictions de méthode" et qui sont non seulement omniprésentes, mais nécessaires. » (JABLONKA, 2015)
Il conteste également la capacité de l’histoire à dire « la » vérité, sans pour autant, bien sûr, considérer que tout n’est que représentation fictionnelle comme le Linguistic turn. « L’histoire ne peut parvenir à aucune vérité, parce que la vérité n’est pas de ce monde et qu’il n’y a aucun critère pour arbitrer entre les différentes versions des faits. Incapable de certitude, elle doit se contenter d’énoncer le vraisemblable et de décrire les passions des hommes » (JABLONKA, 2014 : 106-107) Sa thèse tend à le rapprocher de l’historien Antoine Prost qui, au terme de sa carrière dans les années 1990, propose une réflexion sur le métier d’historien et sa pratique, dans la lignée de Marc Bloch (A. Prost ayant d’ailleurs été fortement influencé par le courant des Annales).
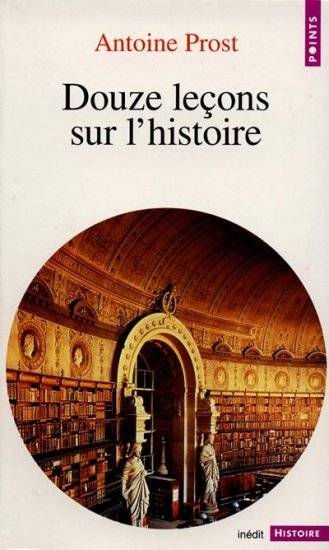
Contrairement à P. Veyne, il place l’importance de la méthode au cœur de sa réflexion, appelant à toujours plus de méthode et de rigueur dans le travail de l’historien, seul moyen de contrer les critiques qui peuvent lui être formulées sur la subjectivité de l’histoire. Celle-ci se base sur l’administration de la preuve, la vérité historienne ne pouvant être que partielle, car provenant uniquement de ce qui est prouvable. Cependant cette méthode inclut la pratique de l’écriture historienne avec des techniques et un vocabulaire commun à la littérature : toute une partie du travail de l’historien consiste déjà en une « mise en intrigue » correspondant à la définition et au découpage de son sujet. L’histoire accorde de plus une large place à l’imagination guidée par des hypothèses alternatives permettant au chercheur de se mettre à la place des personnages qu’il étudie et de rechercher les causes de tel ou tel événement (PROST, 1996).
On observe effectivement dans les travaux d’historiens depuis ces années le retour de cette dimension littéraire avec par exemple les what if history (les uchronies) très populaires aux Etats-Unis qui consistent à décrire un passé qui n’a pas eu lieu, à partir d’une bifurcation imaginée de l’histoire. C’est un jeu autour des hypothèses alternatives mises en évidence par A. Prost. L’historien Patrick Boucheron s’y est par exemple prêté en imaginant un dialogue entre Léonard de Vinci et Machiavel. Ce retour de la littérature en histoire se remarque également avec l’essor de la parution de biographies. En outre en France, l’essor de l’histoire culturelle et des sensibilités ainsi que la microhistoire venue d’Italie a amené les historiens à adopter une écriture plus littéraire, afin d’approcher au mieux les sensibilités humaines qu’une histoire « scientifique » plus quantitative. On peut ici citer le travail d’Alain Corbin et Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot (Flammarion, 1998) où l’auteur donne une dimension romanesque à son ouvrage en se mettant lui-même en scène dans son introduction avec des extraits de carnet de bord, et où il frôle la fiction en émettant les hypothèses probables de ce qu’a pu être la vie de ce sabotier analphabète inconnu dans le Perche au XIX° siècle sans pour autant réellement établir des faits.
Toutefois ce retour en force de la littérature de l’histoire n’enthousiasme pas de façon égale tous les historiens, P. Boucheron affirmant par exemple que « la tentation littéraire de l’historien est un aveu de faiblesse » (BOUCHERON, 2011).
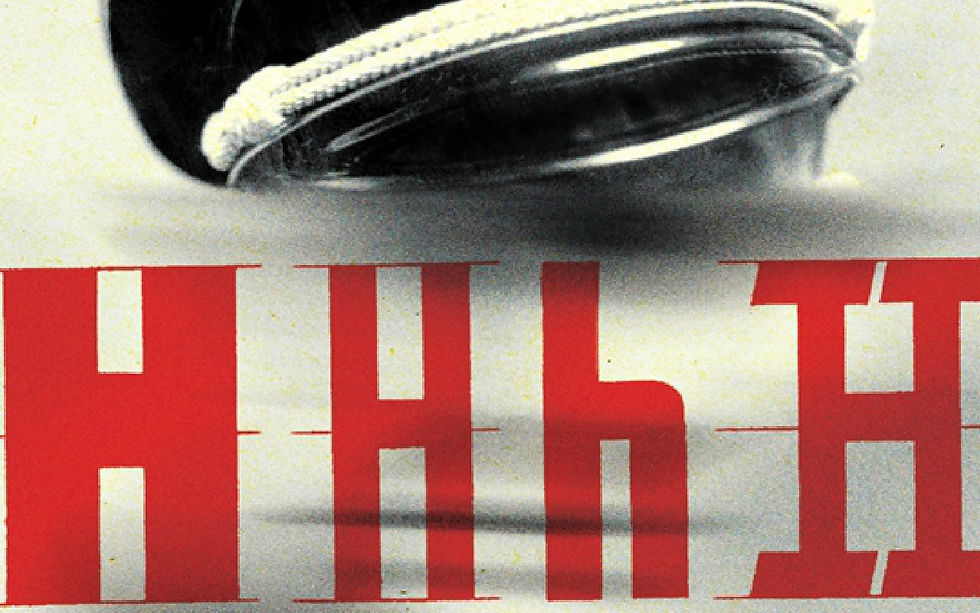
La parution récente de trois romans historiques, Les Bienveillantes de Jonathan Littel (Gallimard, 2006), Jan Karski de Yannick Haenel (Gallimard, 2009) et HHhH de Laurent Binet, ont fortement réanimé le débat sur la frontière entre littérature et histoire, ramenant sur le devant de la scène la capacité des romanciers, plus grande peut-être que celle des historiens, à rendre compte du vrai. Antoine Compagnon, professeur de littérature au Collège de France, évoque cette puissance de la littérature : « La littérature doit donc être lue et étudiée parce qu’elle offre un moyen - certains diront le seul - de préserver et de transmettre l’expérience des autres, ceux qui sont éloignés de nous dans l’espace et le temps » (COMPAGNON, 2007). Ces romanciers, s’emparant du thème délicat de la Seconde Guerre Mondiale et de la Shoah jusqu’alors réservé aux historiens, pose problème à ces derniers. « Par-delà la diversité de points de vue, la communauté historienne a exprimé plus ou moins clairement un sentiment de mise en concurrence, voire d’une véritable expropriation par la littérature d’un domaine qui lui serait propre » (LOYER, 2010). Comme l’exprime P. Boucheron, la littérature vient en quelques sortes combler les vides de l’histoire et les historiens ont un peu le sentiment, face à de telles productions, de ne plus avoir qu’à critiquer le travail créatif des auteurs. Toutefois pour enrichir le débat sur la frontière entre littérature et histoire, il faut dépasser cette impression contre-productive de compétition ressentie surtout chez les historiens.
« Faire profession d’historien consiste peut être à admettre une fois pour toutes que l’on n’aura pas le dernier mot. Parce que la puissance de séduction du mensonge romanesque est irrépressible, l’historien a pour vocation de se faire contredire par plus ignorant que lui. » (BOUCHERON, 2011)
Comme Emmanuelle Loyer, historienne au cœur de ces récentes réflexions, chacun doit admettre que le travail de l’autre l’inspire et l’enrichit au-delà de la sphère privée. L’histoire peut fournir un important point de départ aux romanciers, lus par les historiens avec une attention supérieure à celle du simple divertissement, les romans historiques créant parfois de véritables vocations d’historiens.
Les Annales notamment, assez sceptiques vis-à-vis de la résurgence de la tentation littéraire de l’historien, ont accepté ces faits et ont proposé de déplacer légèrement le débat en cherchant à « saisir historiquement les capacités de la littérature à produire un savoir sur le monde, sans postuler que ce savoir soit d’une nature supérieure et irréductible à celui des sciences sociales » (ANHEIM et LILTI, 2010) en réaction à la sortie de ces romans. Cette question (qui leur permet aussi de réfuter tout véritable mélange entre histoire et littérature) n’est pas nouvelle comme nous l’avons vu en première partie avec les romans historiques et réalistes du XIXème siècle.
« La valeur exemplaire de la littérature […] vient de sa capacité à proposer une forme d’interprétation du monde détachée de l’individu qui lui a donné naissance. Là où les sciences sociales procèdent elles aussi à l’institutionnalisation d’un discours individuel, mais normé par des procédures scientifiques, la littérature produit du paradigme par la canonisation d’œuvres exemplaires qui deviennent disponibles pour décrire le monde. » (ANHEIM et LILTI, 2010)
Ces savoirs propres à la littérature ne doivent pas être confondus avec les usages de la fiction suggérant une logique binaire et simpliste réalité/fiction, vrai/faux qu’il faut savoir dépasser pour mener une réflexion approfondie. En 1989, l’historien et philosophe Krysztof Pomian écrivait d’ailleurs : « Le roman en tant que genre littéraire, tout en revendiquant son appartenance à la fiction, ne s’y laisse pas enfermer complètement. Car l’imagination créatrice y cohabite presque toujours avec la connaissance, la fiction avec une réalité, l’invention avec la vérité » (POMIAN, 1989). Ainsi,
« la question du savoir proprement historique de la littérature peut être posée de façon renouvelée : il ne s’agit pas d’opposer la fiction et l’histoire autour de la représentation de la réalité empirique des faits passées, mais plutôt de montrer comment la littérature permet de penser l’historicité de l’expérience humaine dans son rapport au temps, à l’attente, à la guerre ou à la mort. » (ANHEIM et LILTI, 2010)
Plus que la question du vrai/faux, il faut davantage se pencher sur celle de la vraisemblance, du réalisme, entendu « dans le sens plus large de la vocation référentielle de la littérature ; de sa tentative de décrire et de donner sens au monde ». Il en va de même dans la production historienne où « le grand critère de vérité que l’histoire utilise est un critère de contemporanéité, selon lequel une chose est réputée vraie ou fausse selon qu’elle est ou non contemporaine avec ses conditions de possibilité » (ANHEIM et LILTI, 2010).
Enfin il faut vraiment envisager les savoirs issus de la littérature dans un processus d’interactions. P. Boucheron souligne d’ailleurs « [l’]insuffisance des formes romanesques à faire littérature, [l’]insuffisance du récit journalistique à dire le monde, [l’]insuffisance de l’écriture académique à donner l’histoire en partage ». Les savoirs ressortant de la littérature et ceux issus des sciences sociales et même de toute recherche s’enrichissent donc mutuellement. « C’est en littérature que s’exprime tout ce qui creuse le temps des historiens : le déni et l’oubli, les filiations rompues, ce que l’on sait vrai mais que l’on ne veut pas croire, les délires de la mémoire, l’interminable nuit blanche du silence. » (BOUCHERON, 2010). Dans le cas des trois romans autour de la Shoah, les romanciers viennent s’emparer de sujets délicats, difficiles à traiter pour tenter de faire ressortir par d’autres moyens (les procédés littéraires usant aussi du travail sur documents et témoignages comme les historiens) ce qui était alors considéré comme « irreprésentable » afin de répondre à une demande sociale, une demande de mémoire mais aussi de compréhension plus sensible de ce qu’il s’est passé. « Un roman ne peut porter de "faux témoignage" sur le temps de sa narration ; il ne témoigne de rien d’autre que d’un certain état de la mémoire contemporaine » (BOUCHERON, 2010).

L’histoire énonce des vérités partielles comme nous l’avons vu, et elle n’est pas la seule d’ailleurs à pouvoir établir cette vérité, les romans historiques contemporains, avec des techniques qui leur sont propres, peuvent également rendre compte du « vrai » en lien avec les attentes sociales. L’histoire ne peut donc avoir le monopole du « roman vrai » comme l’écrivait P. Veyne car on pourrait aussi associer ce terme aux romans historiques contemporains cités dans la partie précédente. Mais l’histoire peut-elle vraiment être considérée comme un roman ? Les récents articles parus sur la question de la frontière entre la littérature et histoire montrent que certes celle-ci est poreuse, mais qu’elle existe bel et bien. On peut déjà citer comme différence première le caractère atemporel des œuvres littéraires (et donc des romans) tandis que les travaux des historiens sont voués à l’obsolescence, leurs propos étant sans cesse discutés et réactualisés.
P. Nora met notamment en évidence trois lignes de démarcation entre l’histoire et la littérature. « L’histoire, à la différence du roman que l’on peut écrire que pour se distraire, certifie l’existence d’un monde commun ». Elle est, comme un bien de consommation, le résultat d’une production. C’est « un produit social, qui parle du social et renvoie au social. Elle présuppose l’existence d’un domaine publique ». De plus « l’historien intervient toujours dans un champ constitué » où les questions abordées sont « déjà formulée[s] » et où son travail doit s’ancrer dans une « tradition déjà constituée » qu’il vient enrichir ou réfuter. Enfin si l’histoire s’appuie effectivement sur l’imaginaire, comme le roman, pour retranscrire la vérité, l’attachement de l’historien au principe de réalité est absolu tandis que le romancier peut s’en affranchir selon sa créativité et les besoins de son propos.
« Si l’écriture romanesque est celle à qui tout est permis, à qui tout est même demandé, l‘historien est au contraire celui qui sait et qui dit ce que l’histoire permet et ce qu’elle ne permet pas. […] il n’y a pas d’historien sans attachement absolu au principe de réalité. » (NORA, 2011)
Jean-Yves Tadié, qui a travaillé sur la question de l’esthétique des genres littéraires, a relevé les spécificités de l’écriture romanesque « à qui tout est permis » pour reprendre les propos de P. Nora, qui la distingue de l’histoire. Dans un roman, la psychologie des hommes est essentielle, tandis qu’elle est plus secondaire en histoire.
« Les héros de roman se souviennent, non ceux de l’histoire, pris dans un déroulement du passé vers le futur. Les héros de roman sont pleins de désirs non réalisées, qui importent peu à l’historien. Il a trop à faire avec le réel pour spéculer longuement […] Ses personnages n’ont pas d’intériorité. » (TADIÉ, 2011)
D’ailleurs, un ouvrage d’histoire peut se passer de héros en se focalisant sur l’économie ou le climat, ce qui est inenvisageable dans un roman. Sur les procédés d’écriture enfin, alors que « le dialogue est essentiel au roman », il est absent de l’ouvrage d’histoire « qui est entièrement récit, ou discours explicatif » (TADIÉ, 2011). Le récit du romancier est aussi narratif dans son intégralité tandis que le récit de l’historien s’interrompt régulièrement pour des discussions.
Finalement une différence majeure entre littérature et histoire empêchant d’affirmer que cette dernière est un roman est le rapport que romanciers et historiens entretiennent avec leurs lecteurs. A. Corbin énonce que l’historien fournit « à son lecteur les éléments qui permettront à celui-ci d’écrire lui-même, dans sa tête, le roman historique retraçant la vie de l’individu étudié » (CORBIN, 2011) se référant ainsi à toute l’administration de la preuve qu’opère l’historien, contrairement au romancier qui pose telle qu’elle sa fiction sortie de son imaginaire sans rendre tangible les preuves qui l’ont mené à écrire ce récit. Contrairement à ce que pouvait affirmer P. Veyne « L’historien peut s’arrêter dix pages sur une journée et glisser en deux lignes sur dix années : le lecteur lui fera confiance, comme à un bon romancier » (VEYNE, 1971 : 31), la confiance qu’accorde le lecteur dans les propos du romancier ou de l’historien est différente. L’historienne Mona Ozouf a bien synthétisé les différents pactes opérés : « La croyance dans ce que dit l’historien est à la fois forte et conditionnelle » puisqu’on ne doute pas des faits relatés par l’historien tout en sachant que ses connaissances peuvent être « nuancée[s], complétée[s], enrichie[s], possiblement contestée[s] aussi, par une autre narration historique, tant il est vrai que toute histoire est révisionniste. ». En revanche, « la croyance dans la narration romanesque est à la fois faible, et inconditionnelle » car l’on n’est pas certain de l’existence de grands héros comme Jean Valjean et de leurs exploits mais, une fois que l’on se prête au jeu de la fiction, la croyance accordée au romancier « ne peut être ni infirmée ni même corrigée par une autre narration » (OZOUF, 2011).
Il paraît donc impossible de faire tomber cette frontière et de faire fusionner l’histoire et la littérature, ou d’affirmer que l’une est un sous-genre de l’autre. Ce serait certainement réducteur et contre-productif. Cette démarcation est en perpétuel mouvement car « toute littérature est assaut contre la frontière » (BOUCHERON, 2010) et c’est justement tout l’intérêt de la porosité entre les deux disciplines qui leur permet d’évoluer au regard l’une de l’autre et de sans cesse se renouveler. L’histoire n’est pas un roman car, si elle emprunte des techniques d’écriture similaires à la littérature, son travail résulte de l’usage rigoureux d’une méthode destiné à rendre compte de façon pédagogique au lecteur « ce que nous pouvons savoir encore de » (VEYNE, 1947) telle ou telle époque, tel ou tel événement, ce qui est prouvable, le lecteur ayant des attentes précises à l’égard de l’historien. Néanmoins cette administration de la preuve ne doit pas conduire à dégrader le travail des romanciers, capables eux aussi de fournir des connaissances spécifiques qui, par l’usage du vraisemblable, viennent exprimer autrement « l’irreprésentable » répondant d’ailleurs davantage à une demande sociale de mémoire. Aucune de ces disciplines ne dit le vrai mais elles viennent s’enrichir mutuellement dans les explications et les représentations du monde qu’elles proposent, chacune devant être apprécié à sa juste valeur sans esprit de concurrence. « Trop de littérature et l’histoire se meurt ; pas assez de littérature, et il n’y a plus rien » (JABLONKA, 2014).
« Parce qu’elle est l’instance de médiation sur les illusions de la représentation historique, qu’elle soit littéraire ou historiographique, parce qu’elle énonce par ses pouvoirs propres un possible monde commun sur les ruines d’une mémoire pathogène, la littérature a une politique commune à mener avec l’histoire pour le siècle à venir. » (LOYER, 2010)

BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages :
COMPAGNON Antoine, La littérature pour quoi faire ?, Paris, Collège de France, 2007
DE CERTEAU Michel, L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975
GENGEMBRE Gérard, Le roman historique, Paris, Klincksieck, 2006
JABLONKA Ivan, L’histoire est une littérature contemporaine : manifeste pour les sciences sociales, Paris, Seuil, 2014
PROST Antoine, Douze leçons sur l’Histoire, Paris, Seuil, 1996
SEGINGER Gisèle (textes réunis par), Écriture(s) de l’histoire, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2005.
VEYNE Paul, Comment on écrit l’histoire, Paris, Seuil, 1971
Articles :
In Les Annales, 65e année, Février 2010 :
ANHEIM Etienne et LILTI Antoine « Introduction »
BOUCHERON Patrick, « Toute littérature est assaut contre la frontière »
BOUJOU Emmanuel, « Exercice des mémoires possibles et la littérature ‘’à-présent’’. La transcription de l’histoire dans le roman contemporain »
In Le Débat, n°165, Mars 2011 :
BOUCHERON Patrick, « On nomme littérature la fragilité de l’Histoire »
CORBIN Alain, « Les historiens et la fiction »
GENGEMBRE Gérard, « Histoire et roman aujourd’hui : affinités et tentations »
NORA Pierre, « Histoire et roman : où passent les frontières ? »
OZOUF Mona, « Récit des romanciers, récit des historiens »
TADIE Jean-Yves « Les écrivains et le roman historique au XXe siècle »
POMIAN Krysztof, « Histoire et fiction », in Le Débat, n°54, Février 1989
GENGEMBRE Gérard, « Le roman historique : mensonge historique ou vérité romanesque », in Etudes, tome 413, Octobre 2010
EL NOSSERY Névine, « Le roman historique contemporain ou la voix / voie marginale du passé », in French Cultural Studies, n°20, Août 2009
LOYER Emmanuelle, « L’histoire au défi du roman », in L’Histoire, n°357, Octobre 2010
JAUBERT Martine, LALAGÜE-DULAC Sylvie, LOUICHON Brigitte, « Les fictions historiques : un objet littéraire, éditorial et scolaire qui interroge les frontières », in Repères, n°48, 2013
Entretien avec JABLONKA Ivan, propos recueillis par TESTOT Laurent, « Du bon usage des fictions en histoire », in Sciences Humaines, n°273, Juillet-Août 2015




















Comments